Le 9 octobre 2025, nous partons à la rencontre des artisans vitraillistes pour une plongée au cœur des Ateliers Gouty à Cormeilles (27), où la restauration des vitraux de la basilique a commencé : nettoyage, dessertissage, découpe du verre, remise en plomb, peinture sur verre…
On assiste à la transmission d’un savoir-faire pluriséculaire. Gabrielle, Roxane, Ivanhoé, Isabelle et Dimitri détaillent les étapes : relevé, calque, coupe, sertissage, cuisson des grisailles et du jaune d’argent. On découvre aussi le parcours des artisans, leur formation, leur passion patiemment mûrie, ainsi que les choix techniques qui assurent la stabilité et la lisibilité des verrières dans le temps. Cette restauration s’inscrit dans la mission du sanctuaire : entretenir la beauté de ce patrimoine au service de la prière et de la mémoire des défunts.
En savoir plus sur les étapes de restauration : https://www.ateliergouty.com/les-etapes-de-restauration-procede/

Pourquoi restaurer les vitraux anciens ?
Avec le temps, le plomb se fatigue. Les verres se déforment, les soudures faiblissent, les mastics s’altèrent. L’environnement aussi agit : poussières, sels, condensation, corrosion superficielle et micro-fissures fragilisent l’ensemble. Par conséquent, les scènes perdent en lisibilité et la structure du panneau se met en tension. Restaurer, c’est d’abord stabiliser : retrouver la planéité, renforcer les assemblages, protéger les verres. C’est aussi retrouver la lecture : nettoyer les dépôts, reprendre les peintures écaillées, vérifier la cohérence des teintes. Enfin, c’est préserver : mettre en place des protections adaptées et documenter chaque intervention. Ainsi, nous respectons la matière d’origine, nous limitons les remplacements, et nous assurons la transmission de ce patrimoine aux générations qui prieront ici demain.


Les étapes clés de la restauration des vitraux
La méthode suit un chemin éprouvé. D’abord, relevé, calque et photos fixent l’état initial. Ensuite, dessertissage et nettoyage libèrent chaque pièce de verre. Nous contrôlons les coupes, remplaçons à l’identique les fragments altérés ou brisés et consolidons ceux qui peuvent l’être. Puis vient la remise en plomb, les soudures à l’étain et le masticage pour l’étanchéité.

La peinture sur verre (grisaille) et le jaune d’argent sont cuits au four, selon les besoins, afin de restituer traits, ombres et rehauts. Enfin, les panneaux sont reposés, avec protections et drainage adaptés. Ces gestes prolongent la tradition artisanale, comparable au cloisonné : des pièces colorées reliées par un réseau de plomb pensé comme un élément du dessin lui-même. Ainsi, la technique sert la catéchèse par l’image et la beauté de la lumière.
En savoir plus sur les techniques du vitrail :
https://www.britannica.com/art/stained-glass/Traditional-techniques


L’art de sculpter la lumière, une brève histoire du vitrail
Le vitrail naît comme un art de la lumière. Il assemble des pièces de verre, serties de plomb, pour raconter l’Évangile et magnifier l’architecture. En Europe, son apogée s’étend du XIIᵉ au XVe siècle, avec de grandes verrières gothiques. Un vitrail est appelé vitrerie lorsque son dessin est géométrique et répétitif – des losanges ou des bornes par exemple – comme c’est le cas pour les vitreries des tours de Notre-Dame de Montligeon. La vitrerie est généralement claire et sans peinture. La grisaille se développe au XIIIᵉ siècle pour gagner en clarté. Puis le jaune d’argent apparaît au début du XIVᵉ siècle : appliqué et cuit, comme l’explique Dimitri, il “teinte” le verre clair de nuances dorées et enrichit les compositions. Cette invention, datée en France dès 1313 (Le Mesnil-Villeman, Manche), marque une étape décisive. Enfin, les techniques traditionnelles — coupe, sertissage, peinture à la grisaille, cuisson — restent le vocabulaire de base jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, restaurer un vitrail signifie servir une histoire, une technique et une théologie de la lumière.

En 2025, le travail est refait à l’identique des travaux de Louis Barillet en 1925, mais les vitreries sont modifiées pour permettre l’ajout de cartouches « donateurs » en remerciement des dons qui ont permis de reprendre les travaux de restauration cette année.
Pour en savoir plus sur les travaux confiés par Mgr Lemée à son ami Louis Barillet sur les vitraux de la basilique Notre-Dame de Montligeon, on peut se procurer le magnifique ouvrage de Servanne Desmoulins-Hémery et Francis Bouquerel « Que la lumière soit ! Le vitrail dans l’Orne » La page 94 est consacrée à la verrière de la Rédemption de la basilique. En vente à la boutique du sanctuaire.
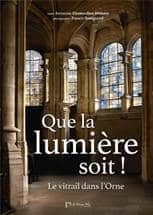
Que la lumière soit ! Le vitrail dans l’Orne,
éditions La Mésange Bleue – Mai 2024
https://infovitrail.com/publications.php/fr/d/-que-la-lumiere-soit-/c6984313-1e51-4176-91cc-7e7952021bd7
Une découverte émouvante : les signatures de 1925 des artisans des ateliers Louis Barillet

Lors de la dépose des premiers panneaux, l’équipe de l’atelier Gouty a eu une surprise. Après le dessertissage et le nettoyage verre par verre des quarante vitraux de la tour nord, des inscriptions sont apparues. « Nous avons découvert un trésor », confie Cyril. Les anciens poseurs ont laissé des pièces signées et des marques d’atelier, véritables témoins de la création d’époque. Sur l’un des verres, on lit la mention laissée par le poseur belge, « Johns Jean Baptiste, né à Molenbeek-Saint-Jean – Belgique », avec la date de pose « 21-04-1925 ». « Et nous, nous restaurons pile cent ans après ! », s’émerveille Cyril. Ces éléments renvoient aux ateliers de Louis Barillet, maison réputée à Paris, qui a également œuvré au transept et aux verrières du chœur de la basilique. « C’est rare de voir un témoignage pareil, gravé à la pointe de diamant, avec la date et la signification », ajoute-t-il. À leur tour, les équipes de l’atelier Gouty souhaitent laisser une trace pour l’avenir : « Signer la restauration en 2025, pour les prochains, en 2125. » Ainsi, la chaîne du métier se prolonge, de main en main, dans la lumière.
Louis Barillet, né à Alençon en février 1880 est une figure de proue du renouveau du vitrail moderne en France. Il fréquente l’école des beaux-arts de Paris et rejoint le groupe des artisans de l’autel fondé en 1919, une société d’artistes chrétiens. II y rencontre Jacques Le Chevallier et le belge Théodore Hanssen, ses associés dans l’atelier qu’il crée en 1920 (source : Que la lumière soit, le vitrail dans l’Orne, page 82). On comprend mieux pourquoi on retrouve la signature d’ouvriers Belge sur le chantier de la Chapelle-Montligeon.

Un patrimoine au service de la prière
À Montligeon, la beauté n’est pas un luxe. Elle soutient la prière et la mémoire des défunts. Restaurer les vitraux, c’est offrir aux pèlerins un cadre digne pour confier leurs proches au Seigneur. De plus, ce chantier s’inscrit dans notre mission : transmettre l’espérance. Bien sûr, vous pouvez y prendre part. Votre soutien permet à la mission de prière pour les défunts de continuer et de porter vos intentions. » Rejoignez nos donateurs, demandez une intention de messe ou rejoignez un groupe de prière pour les défunts de la Fraternité Notre-Dame de Montligeon. Ainsi, vous participez concrètement à la transmission d’un patrimoine vivant et à la consolation de nombreux cœurs. Merci pour votre soutien fidèle.
Une basilique
en danger
Présentation des travaux (PDF à télécharger) :
2022-04-12-Montligeon-Batisseurs-Esperance-Ambassadeurs





Nous sommes avec vous de tout coeur.Cordialement.